Le Barbier de Séville
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
En italien avec surtitres en italien et en anglais
SAISON D’OPÉRA ET DE BALLET 2025–26
LE BARBIER DE SÉVILLE
Musique de Gioachino Rossini
Argument
Ouverture
Un solennel andante maestoso l'ouvre suivi sans transition par un allegro vivo, mouvementé et moqueur qui indique la nature comique de l'opéra. Cette deuxième partie comporte notamment deux célèbres crescendi successifs, marque de fabrique du compositeur, reprenant les mélodies de l'andante. Le deuxième crescendo débouche sur une brève coda Più mosso qui conclut gaiement l'ouverture.
Acte I
1er tableau
Nous sommes à Séville, où la nuit est déjà noire. Le comte Almaviva vient chanter une sérénade devant la maison du vieux docteur Bartolo.
« Ecco ridente in cielo »
Sa chanson s’adresse à Rosina, la jeune et belle pupille du docteur. Figaro, un ancien domestique du comte, barbier-chirurgien de Bartolo, fait une joyeuse entrée.
« Largo al factotum »
Le comte Almaviva lui demande son aide. Mais voilà que Rosina paraît au balcon et laisse tomber un billet dans lequel elle invite le comte à se présenter. Ce qu’il fait dans une nouvelle sérénade où il dit s’appeler Lindor, être pauvre, et très amoureux. Figaro lui conseille ensuite de se présenter chez Bartolo avec un billet de logement. Pour mieux égarer les soupçons, il aura l’air à moitié ivre.
2e tableau
Rosina, seule, chante son amour pour Lindor et sa détermination d’échapper à son tuteur.
« Una voce poco fa »
Ce dernier paraît, fulminant contre Figaro qui vient de donner médecine à toute la maison. Mais voici qu’entre Basilio, le maître de musique de Rosina, qui vient prévenir Bartolo de la présence à Séville d’Almaviva. Comment lutter contre lui ? Par une arme terrible, la calomnie, répond Basilio.
« La calunnia è un venticello »
Puis, pendant que tous deux vont préparer le contrat de mariage qui doit unir Bartolo à Rosina, Figaro prévient cette dernière, d’une part que son tuteur veut l’épouser dès le lendemain, d’autre part que Lindor l’adore. Rosine ravie remet à Figaro un billet doux déjà préparé pour Lindor. À peine Figaro est-il sorti que Bartolo fait irruption, plus soupçonneux et inquisiteur que jamais. Il n’est pas, proclame-t-il, un homme qu’on berne facilement.
« A un dottor della mia sorte”
Mais voici qu’Almaviva déguisé en soldat se présente. Bartolo lui réplique en brandissant un certificat l’exemptant de toute réquisition. Du coup le dialogue s’échauffe, et le comte en profite pour glisser un billet à Rosina. Figaro accourt, puis c’est la garde qui vient arrêter le fauteur de désordre. Mais le comte fait discrètement savoir qui il est, et la garde se retire, laissant tout le monde dans l’ébahissement.
Acte II
Bartolo s’interroge sur l’identité du soldat qui s’est introduit chez lui, quand un nouveau venu se présente. C’est Alonso, un élève de Basilio remplaçant son maître pour la leçon de Rosina. Basilio, dit-il, est souffrant. Alonso, bien sûr, n’est autre qu’Almaviva déguisé. Bartolo restant méfiant, le comte utilise pour lever ses soupçons le billet doux que lui a fait parvenir Rosina. Il prétend l’avoir reçu par hasard à la place d’Almaviva, et suggère de l’utiliser pour calomnier ce dernier. Bartolo reconnaît là les procédés chéris de Basilio et fait bon accueil à Alonso. La leçon commence. Mais la musique endort Bartolo, et les amoureux en profitent pour se livrer à des apartés passionnés. Là-dessus entre Figaro, venu pour raser le docteur. Il parvient à lui subtiliser la clé de la porte du balcon. Mais c’est alors que surgit Basilio, à la grande surprise de Bartolo. Il faut trouver d’urgence une solution. Une bourse bien garnie convainc Basilio qu’il est très malade et qu’il doit retourner au lit au plus tôt. Figaro rase donc Bartolo, mais ce dernier surprend des propos non équivoques des amoureux. Il entre dans une rage folle, chasse tout le monde, et envoie chercher le notaire pour précipiter son mariage. Puis il montre à Rosina le billet qu’elle avait écrit comme preuve de la légèreté d’Almaviva. Rosina, effondrée répond à Bartolo qu’elle consent à l’épouser sur-le-champ. Mais Figaro et le comte se sont introduits dans la maison grâce à la clé dérobée. Rosina repousse le comte, mais celui-ci n’a pas de mal, en dévoilant son identité, à se justifier. Ils se préparent à s’enfuir discrètement.
Requis pour le contrat de mariage, Basilio et le notaire arrivent et produisent le document que signent Rosina… et Almaviva bien sûr ! Un pistolet et un bijou de prix convainquent Basilio d’accepter d’être témoin. Et Bartolo ne peut que s’incliner, et constater l’inutilité de ses précautions.
Programme et distribution
Chef d’orchestre : ENRICO CALESSO
Mise en scène, décors et costumes : PIER LUIGI PIZZI
Chef de chœur : PAOLO LONGO
Nouvelle production de la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Personnages et interprètes :
Figaro : ALESSANDRO LUONGO
Rosina : ANNALISA STROPPA
Le Comte Almaviva : MARCO CIAPONI
Bartolo : MARCO FILIPPO ROMANO
Orchestre, chœur et équipe technique : Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Théâtre Verdi de Trieste
Le Teatro Lirico Giuseppe Verdi est un opéra situé à Trieste, en Italie, qui porte le nom du compositeur Giuseppe Verdi. Construit par des particuliers, il a été inauguré sous le nom de Teatro Nuovo pour remplacer le plus petit « Cesareo Regio Teatro di San Pietro » de 800 places le 21 avril 1801 avec une représentation de Ginevra di Scozia de Johann Simon Mayr. Au départ, le Nuovo comptait 1 400 places. En 1821, il est devenu connu sous le nom de Teatro Grande.
À la fin du XVIIIe siècle, le besoin d'un nouveau théâtre à Trieste est devenu évident. Son théâtre principal, le Teatro di San Pietro, était devenu de plus en plus inadéquat et a finalement fermé ses portes en 1800. Une proposition de Giovanni Matteo Tommasini à la Chancellerie autrichienne pour construire un théâtre privé existait depuis 1795 et, en juin 1798, un contrat a été établi selon lequel le financement annuel proviendrait de la municipalité et Tommasini détiendrait les droits sur plusieurs loges et le droit d'en vendre d'autres. Gian Antonio Selva, l'architecte de La Fenice à Venise, a été engagé et il a conçu un auditorium classique en forme de fer à cheval. Cependant, ses conceptions extérieures ont été considérées comme trop simples pour les Autrichiens qui ont alors engagé un autre architecte, Matteo Pertsch, pour résoudre le problème, ce qui a été accompli en incorporant des éléments de la Scala de Milan. Le « Nuovo » est devenu un mélange de La Fenice à l'intérieur et de La Scala à l'extérieur.
Histoire
Plusieurs changements de nom ont eu lieu au cours de l'existence du théâtre, le premier en 1821 lorsqu'il est devenu le Teatro Grande [1] et c'est sous ce nom que le théâtre a été le théâtre de deux premières d'opéras de Verdi : Il corsaro en 1848 (avec la soprano Giuseppina Strepponi, que Verdi a épousée en 1859, dans le rôle principal) et Stiffelio, une production que Verdi a supervisée - non sans controverse - en 1850. [2] Cependant, avant ces premières, les opéras de Verdi avaient commencé à dominer la scène du Teatro Grande, suivis, au fil du siècle, par toutes les œuvres majeures du répertoire d'opéra, y compris celles de Puccini et Wagner.
Un autre changement de nom a eu lieu en 1861 en raison du passage d'une propriété privée à une propriété publique. FrançaisC'est ainsi qu'il devint le Théâtre Communal et exista comme tel jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1881, la capacité d'accueil avait été augmentée à 2 000 places grâce à l'utilisation des places debout existantes ; mais, en décembre de cette même année, le théâtre fut déclaré dangereux et il fut fermé pour rénovation, au cours de laquelle l'électricité remplaça l'éclairage au gaz pour la réouverture en 1889 avec 1 000 places.
Quelques heures après sa mort en janvier 1901,[3] le théâtre fut à nouveau rebaptisé, cette fois pour honorer la mémoire de Giuseppe Verdi. Il fut largement restauré entre 1992 et 1997 et rouvert avec environ 1 300 places[4] et avec un concert Viva Verdi[3] qui comprenait des extraits de nombreux opéras du compositeur. (Comme lors de la restauration de La Scala entre 2001 et 2004, un lieu alternatif temporaire a rapidement été créé à Trieste et la Sala Tripcovich continue d'offrir un espace pour l'opéra de chambre et les opérettes.)
Une caractéristique majeure de la programmation du Teatro Verdi au cours des 40 dernières années, qui découle de l'occupation autrichienne de la ville au XIXe siècle et du fait que Trieste n'est devenue une partie de l'Italie qu'en 1918, est le "Festival international d'opérette" qui a lieu chaque été.
Premières Le théâtre a vu les premières mondiales des opéras suivants : Ginevra di Scozia de Simon Mayr, 21 avril 1801. Annibale in Capua de Antonio Salieri 20 mai 1801 Ricciarda di Edimburgo de Cesare Pugni, 29 septembre 1832. Enrico II de Otto Nicolai, 26 novembre 1839 Il corsaro de Giuseppe Verdi, 25 octobre 1848 Stiffelio par Giuseppe Verdi, 16 novembre 1850 Nozze istriane par Antonio Smareglia, 28 mars 1895

 FR
FR EN
EN DE
DE IT
IT ES
ES RU
RU JP
JP RO
RO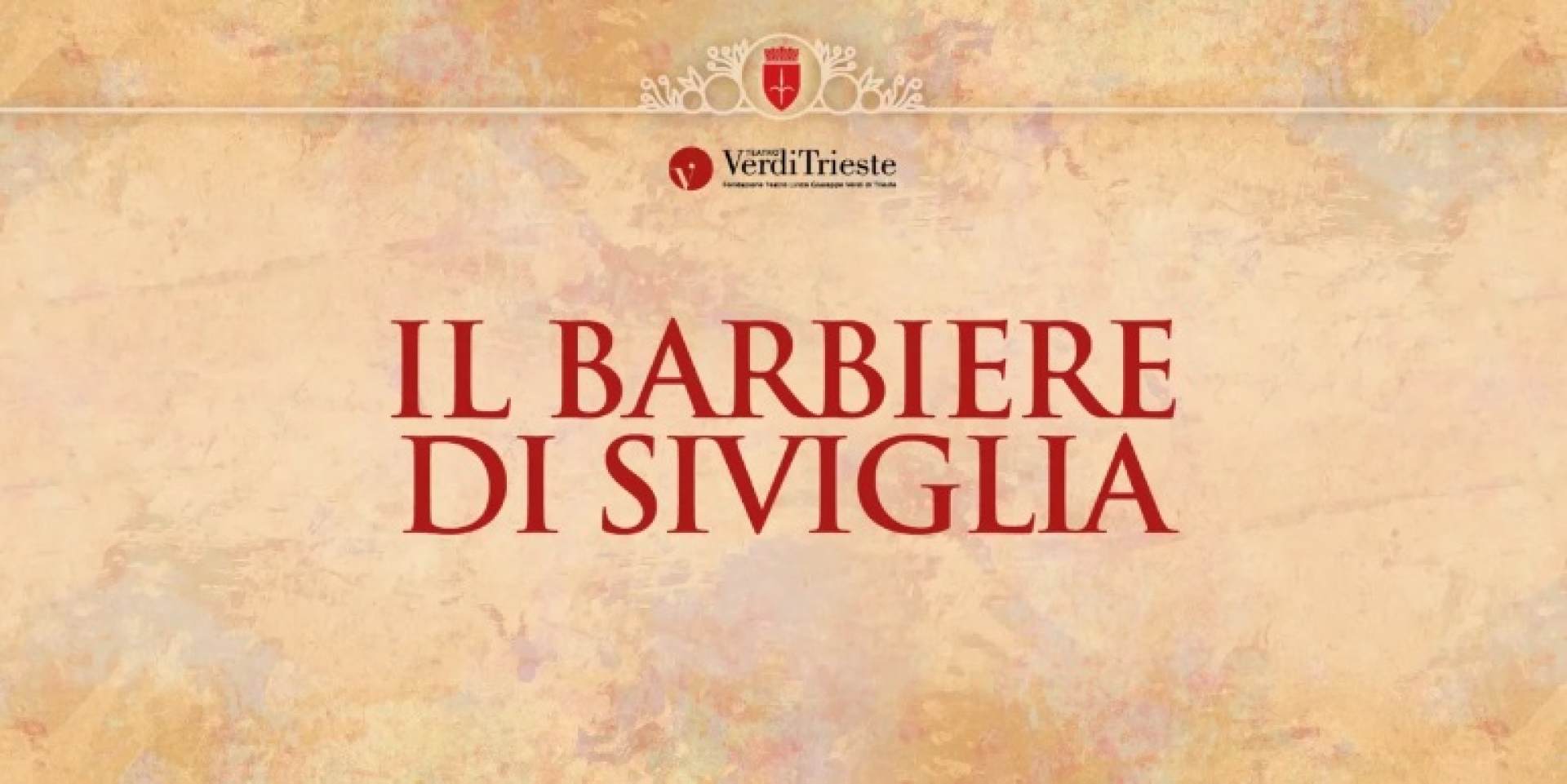
 Plan de la salle
Plan de la salle 